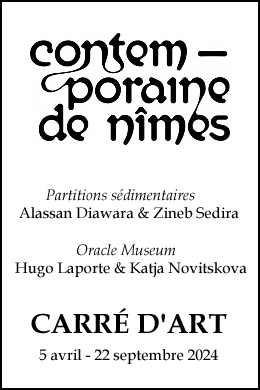Retour sur « Tragédie » d’Olivier Dubois donné au Théâtre de Nîmes le 4 février 2015

Portrait d’une humanité en crise
Succès ! Tragédie pourrait désormais être un classique. Depuis 2012 et sa présentation saluée au Festival d’Avignon, sa persistance dans les salles en France et à l’étranger, le plébiscite par la présence du public, tout du moins, semble significatif d’une adhésion – exception faite de certains discours déjà oubliés, teintés de pudibonderie, mus l’an passé par une tentation populiste et électoraliste. Mais derrière l’engouement, la curiosité et la surprise – car oui, c’est le pouvoir de la rumeur populaire, on vient voir aussi Tragédie parce que l’on croit savoir ce que l’on y montre, des corps nus, mais sans s’attendre au choc que le spectacle suscite, celui-ci recèle bien d’autres raisons pour lesquelles, désormais, cette pièce pourrait prétendre prendre place au sein de la catégorie des chefs-d’œuvre d’aujourd’hui : gros mot de la création contemporaine certes, appartenant au langage pense-t-on éculé des œuvres entrées dans l’histoire, nous affirmons cependant : il y a dans Tragédie quelque chose qui lui donne le droit d’être autant d’hier et d’aujourd’hui et qui, nous en faisons le pari, lui permettra de rester d’actualité demain et longtemps encore.
Tragédie est aussi et d’abord un classique dans le sens du nom qu’elle porte et qui indique ce qu’elle est et ce à quoi elle aspire, un genre, un état d’être et somme toute peut-être l’expression du résultat, d’une lutte, d’un échec ou d’une réussite partielle, question de point de vue, face à la vie. Les personnages, figures intemporelles, alors qu’ils ne témoignent d’aucune illustre identité, déshabillés qu’ils sont par une nudité propre à tout homme dans un état de nature, possèdent en eux et par leurs corps tantôt dominés par un état de culture, tantôt dominants à l’égard de ce qu’ils et les autres sont intrinsèquement – êtres de chair et d’esprit, possèdent en eux, disons-nous, une lourde part d’héroïsme : les corps sont dirigés, vaillants et semble-t-il engagés dans un combat – lequel ? – qui les oblige à une attitude offensive et belliciste. Quel est l’ennemi, sinon le genre humain ? S’agit-il d’une lutte intestine et anthropophage ? Faut-il y voir la volonté de tuer la vanité, les faiblesses et les écarts des invertis ou l’affirmation d’une tentative d’émancipation de ceux-là même, prêts à briser les chaînes de l’ordre social ? Tragédie c’est l’ambiguïté des corps, c’est aussi la discorde inhérente à l’être seul, bousculé par l’altérité d’un voisinage, tantôt séduisant, confortable mais aussi inquiétant et malfaisant. Le trouble naît assurément de la contamination et de la dissémination d’une maladie connue par tous : l’envie et le besoin de l’autre, la rencontre des sexes, des différents et des mêmes. Tragique est le constat : le remède à la solitude provoque la défaillance et la transe.
Ainsi, de la solitude de l’émergence des corps à la multitude de l’être collectif, de l’ordre au désordre des positions et des rapports, de la rigueur à la confusion des gestes et des expressions jusqu’à l’ultime quiétude des uns et de tous, il fallait en être. Mercredi dernier, les planches du Théâtre de Nîmes ont tressailli sous l’effet de la mise en mouvement d’une humanité grave et violente. Quiconque était venu voir cette pièce chorégraphique d’Olivier Dubois, accompagnée de la composition musicale indispensable de François Caffenne, allait devoir faire face, tous sens convoqués, à l’épreuve partagée sur scène par les dix-huit corps nus de femmes et d’hommes, seuls et néanmoins ensemble, emmenés dans une affaire de dérèglements d’un système en marche. Successivement, les corps apparaissent et les attitudes s’installent. La partition est martiale, les troupes clairsemées et l’organisation d’abord soumise à la séparation des sexes. Ils et elles sont les maillons d’une boucle du temps de laquelle émergent des lueurs de peau et des matières de vie, hiératiques, engagées dans un drame augmenté par la mise au pas qu’imprime le rythme sonore aux oreilles des acteurs de l’effort comme à ceux qui, spectateurs captifs, le subissent. C’est long, c’est fort, c’est difficile à soutenir. Il ne peut en être autrement. Le contrat est clair : la tragédie ne fait pas l’économie de l’empathie. Non, n’en déplaise aux spectateurs qui soufflent leur impatience à voix basse devant la performance, il ne s’agit pas d’un spectacle de danse qui flatte les certitudes du beau mais qui touche davantage au sublime. L’esthétique se situe dans le fracas, dans la brèche, dans l’insoutenable difficulté de montrer et de regarder l’allant de l’être faillible. Jusqu’à la rupture. Renouveau ? Mais non, dans le mélange, la coexistence, la communauté anarchique, c’est le pire qui point et cependant le sensible aussi. Les corps alors se disloquent en des fragments et morceaux qui inondent l’espace du plateau, tous azimuts. Danse du Sabbat ! Puis, la raideur devient fluidité, boue ou pâte à modeler. L’homme qui marche c’est aussi l’homme qui tombe, qui se dissout. L’homme qui naît c’est aussi l’homme et sa mécanique dérangeante, avec ses sursauts, sa folie, ses manquements. Mais l’homme qui rampe, l’homme qui sue, c’est aussi, bientôt, l’homme debout avec son libre arbitre. L’homme qui triomphe. L’homme qui salue, l’homme qui retourne à son langage, néanmoins mutique. Indistinctement, c’est l’impermanence de ces qualités et de ces travers, donnés avec une énergie fulgurante et saisis dans un décor nu et un éclairage électrique et même stroboscopique, qui implique autant l’amnésie que la réminiscence par bribes de séquences et de tranches de vie qui toutes font apparaître le souvenir répété d’une humanité à l’assaut, toujours, d’elle-même.
En cela Tragédie c’est aussi et encore une œuvre classique moderne. Oui, car elle posséderait cette qualité du poétique dans l’historique, somme toute, de la modernité baudelairienne. Défaites de la mode du temps, ces figures qui semblent s’extraire de la profondeur et de l’obscurité des temps, s’offrant au regard dans une prime naissance, convoquent autant le sentiment de l’histoire et du présent que de la mémoire intangible, car « la modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable » ¹. Face à elles, nous, hier et aujourd’hui, toutes et tous, nous étions, nous sommes et nous serons nus, vulnérables et démunis. Nous, au devant de la frénésie de ces corps autres, de ce tableau d’humanité et de cette image d’unité dans la diversité, face à cet autoportrait agissant, nous sommes tous hommes. A nos risques et périls. Et demain encore, souvenons-nous en. Vivere memento ! ²
Mickaël Roy