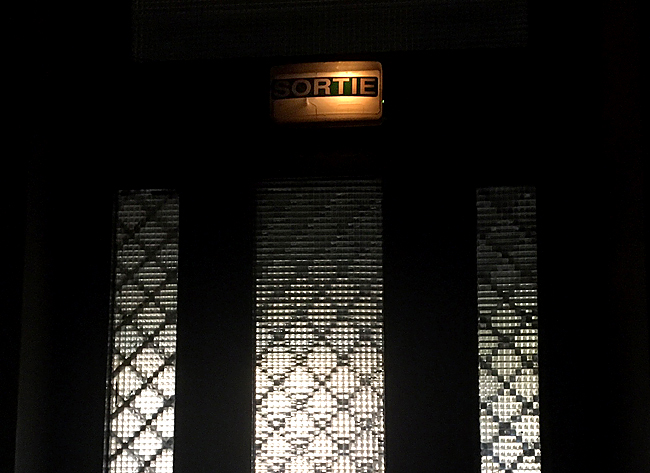« Ma colère » – Corinne Rondeau
La création à l’ordre du jour d’un syndicat d’artistes et d’auteurs [1] est une initiative nécessaire et légitime pour le statut des personnes, nul ne pouvant avoir moins qu’un autre, ce qui est le cas de beaucoup dans le champ de l’art et de la culture. Cependant, il me semble opportun de prendre le temps du détour, et penser en parallèle à l’initiative des questions comme le travail, la visibilité, la liberté.
Telle une perspective invisible, nos regards se dirigent en un point névralgique, le travail. Comme si la vision de l’espace et le sens de nos vies avaient été pris à la gorge, lentement mais sûrement, par ce mot. Avoir ou pas un travail dans une société d’économie néolibérale est une source de souffrance parce que le travail est devenu le mot de la grande entreprise gestionnaire des corps et des esprits. Une entreprise comptable qu’elle soit publique ou privée, qui organise ouvertement ou insidieusement les maltraitances en son unique faveur, profits et réductions de droits en tout genre compris. Nul besoin d’insister sur la conséquence, un champ de vision semblable à nos vies : étriqué, borné, asphyxié.
Par un effet de loupe, la pandémie exacerbe ce qui était à peine voilé, la fragilité d’un système qui avoue ses tragiques dépendances, sa violence, et la brutalité de gouvernants qui n’ont de cesse de nous replonger dans « l’urgence », autre mot qui va si bien à la vitesse délétère du temps dit « d’avant », ce qui signifie qu’on y est toujours. La dignité serait d’arrêter les florilèges sur le temps « d’après », moins pour garder raison que refuser de relancer des projets d’avenir dont on ne sait jamais de quoi il peut être fait. Toujours les effets de manches des discours et de la communication, or ce n’est pas parce qu’on l’a dit qu’on le fait, lapalissade qui vaut mieux qu’un mensonge.
Ce virus nous donne du temps, car il contamine le temps des vitesses sur lequel s’est édifié l’entreprise comptable d’une idéologie totalisante, avec son effet rouleau-compresseur qui laisse derrière lui défaitisme ou révolte. Cet organisme vivant dont la force invisible fait plonger des sociétés entières dans un désastre économique et social, pire que la mort qu’il sème, dit combien notre défaut de structure est celui d’une temporalité inadaptée aux corps et à l’esprit de ceux qui travaillent, dont la finance, qui s’arrange de tout, paraît toujours immune. Ce virus, comme tout le règne du vivant, demande qu’on procède avec un autre temps. Temps il est vrai propice à laisser resurgir rivalité, concurrence et vitesse, un vaccin ! un vaccin ! quand le HIV attend toujours le sien. En contaminant le temps, il nous somme d’être là où nous ne sommes jamais, et depuis si longtemps, au présent qui nous manque et sa durée. Le temps du virus c’est un temps contre le progrès, c’est aussi le temps de nous désenchaîner au lieu de nous déchaîner contre l’orientation flagrante du tout-contrôle sécuritaire et sanitaire. Car se déchaîner prouve seulement combien les chaînes sont à nos pieds, et puisque tout le monde – ou presque – en connait le poids, après avoir perdu trop de temps à lutter, il est temps d’ouvrir de nouveaux chemins. La solution ne serait-elle pas ailleurs et exactement à l’endroit où ça lutte : du côté de l’appétit de vivre.
Preuve des chaînes de notre temps et de la sémantique, l’urgence se décline en « état d’urgence », en « service des urgences », en « urgence économique », rien d’autre qu’une organisation technocratique des fins : politique, vie, société. Le vivant, c’est-à-dire nous, en est asphyxié, maintenu qu’il est par la menace globale des autocraties. Mais qui voudrait d’un ordre de mort, d’une organisation des fins devenue ensemble carotte et bâton, d’une mécanique de normalisation entre des luttes sans fin enterrées, d’un particularisme des droits dans une société qui se targue d’égalité, d’un capitalisme numérique pour que la maison de demain devienne l’avenir d’une prison. L’ordre de mort, qui n’est pas l’action du virus, veut balayer le réel qui est déjà pour partie sous le tapis. Mais un tapis ça se secoue. Le chaos est notre chance, et à ce compte un virus peut aussi être notre miracle. Parce que le réel, d’une incessante mobilité, est l’expérience de la résistance, le chaos doit s’ordonner selon un fatras de vivants qui résistent aux représentations de la réalité, représentations des révolutions passées comprises. Il faut secouer le tapis parce que le réel de nos vies est là, mais écrasé, affamé. Ce fatras est proprement, une liberté des alternatives, des coopérations, et la responsabilité du sens apportée aux gestes inventés.
Ainsi au temps covid-19, un nouveau syndicat voit le jour, le syndicat de travailleurs artistes-auteurs (STAA). Citoyens, ils le sont au même titre qu’un énarque, un éboueur. On entend dire que ce qu’ils font « n’est pas du travail ». L’art et la culture, pas du travail ! On ne s’étonne pas d’y être si mal rémunéré, voire recevoir l’aumône. Pas un travail, mais une économie d’artistes-auteurs bankables qui ne se posent pas la question de leur statut, la reconnaissance médiatique y suppléant, et aussi, conséquemment, la recherche pathologique de visibilité et de réussite.
La naissance d’un syndicat en cette période de crise est sans doute à l’ordre du jour, tant la diminution des droits, des revenus et des aides, là comme ailleurs, risque d’être massive, mais sous la grande arche du numérique et des réseaux sociaux, un autre chemin est possible qui n’a pas l’éclat des apparences mais garantit l’essentiel, une solitude inaliénable, l’obscurité où l’on n’obéit à personne. Que l’initiative advienne en période de régression de la sphère économique et sociale, dit effectivement qu’un syndicat est une structure de gestion, qu’on appartienne ou non au champ de la culture. Sauf que les mots de « syndicat » et « travailleurs » ne sont pas du temps d’un miracle. Je les entends plutôt, hélas, comme un pis-aller, à une époque où plus que jamais il est nécessaire et vital de lutter pour la disparition du travail tel qu’on l’exige de nous. Nos forces sont mises à rude épreuve par une gestion autocratique des vies, et la dévaluation du « métier ». Il n’y a pas toujours eu de « travail », il y a d’autres économies dans un monde de métiers qui ignorent superbement les mots de « compétence » et d’« évaluation » sans pour cela céder sur le talent. Ce qui est incroyable, c’est l’aveuglement, malgré les révoltes justifiées face à l’injustice socio-économique, à vouloir maintenir l’illusion de l’après Trente Glorieuses consécutif à la guerre, tel un système éternel. Pourquoi vouloir renverser encore une fois la table quand la doctrine de l’économie de marché a intégré la spéculation de la pauvreté depuis belle lurette ? Pourquoi choisir un syndicat dont la structure est verticale quand la coopération, condition de notre retour à une juste faim, est horizontale, tout ce qui en définitive ne relève pas d’un projet ou d’un énième programme, et rend possible le présent avec imagination. Coopérer avec imagination, seule condition de retour à la liberté et donc aux alternatives. Car c’est bien là que nous avons été enchaînés, à l’impossibilité de pratiques de liberté qui laissent les rues pleines de gens qui n’en peuvent plus, à raison. Or, il me semble qu’à brandir le mot de liberté nous faisons fausse route contre l’autocratie. L’usage des mots comme celui de lutte ou de liberté masque le présent, versant dans une nostalgie, et un certain romantisme des révolutions auxquelles le néolibéralisme, prompt à s’adapter et à réagir d’un mensonge, d’un mépris, ou d’une énième carotte, a déjà la parade. Si l’imagination ne vient pas à notre renfort, « présent » sera un simple mot de plus, et notre destin d’affamés toujours aussi affamé.
Le « métier » a disparu, et avec lui le bonheur possible du travail, pour devenir de la « professionnalisation », de l’« emploi », un cadrage d’activités qui se situe entre la spécialisation (l’expert) et le chômage (le contrat précaire, l’intérimaire). Un certain nombre d’individus occupent des places convoitées, d’autres des points de calculs de statistiques. Le syndicalisme n’a aucune raison d’échapper au professionnalisme et à la comptabilité. Le seul métier qui a intégré l’industrie culturelle, diffusé à l’envi sur tous les médias, et c’est celui de cuisinier. On nous engraisse les yeux en nous affamant, alors que les rayons de farine et de sucre des supermarchés dévalisés causent la pénurie. Comprendre que la faim n’est pas là où l’on croit.
Je n’hésite pas à dire ma haine du temps qui s’est ainsi formé en monde, notre époque. Ma crainte aussi, si un syndicat d’artistes et d’auteurs ne se donne pas d’abord pour mission de mettre fin au travail qui aliène et affame. Paradoxe ? Non.
« C’est pas du travail ! » Prenons la critique à la lettre, pas pour défendre l’étendard de la création, comme La liberté guidant le peuple, marre des clichés ! Juste pour dire qu’artistes et auteurs manifestent ce qui a été retiré du travail, le désir, le moteur de la créativité. Car qui irait contre le fait que le désir n’existe pas chez n’importe qui ? qu’il est chez tous ceux qui sont à son endroit. Vrai qu’avec la structure du travail tel qu’elle est, les gens meurent et souffrent de l’absence de créativité, d’initiative, d’imagination, et pas que les individus, les collectivités qui voient s’effondrer tous les jours un monde qu’elles portent comme Atlas sur leur dos. Il ne faut pas s’étonner de voir ici ou là nombre d’initiatives anonymes à la recherche de l’autonomie ou parce qu’il n’y a plus de service public. Ce choix n’est pas une lubie d’écolos ou d’anarchistes, ou alors ceux-ci se trompent eux-mêmes, la cause à des têtes toute pleines de représentations des luttes passées qui connaissent si peu leur histoire. Le temps n’est plus à la reproduction, à l’imitation de la force des luttes ouvrières ou autres, forme de refuge quand ça va trop mal, c’est comme d’ouvrir trop de livres pour mettre des fictions entre soi et les drames du réel. La reproduction et l’imitation, et même si je ne parlais que d’art, sont des formes reflexes d’un engourdissement dans la révolte. Une nature morte : s’assimiler à la mort, façon de payer à vie son tribut à la pérennité d’une représentation, alors qu’il faut du mouvement. Il y a une chose merveilleuse dans l’invention de la perspective de Brunelleschi, bien différente du système de projection mathématique dominant jusqu’au XIXème. La merveille ne se trouve pas dans la projection de lignes convergentes en point de fuite, dit aussi le point de l’œil, mais dans un badigeon d’argent bruni pour tout ciel sur la tablette de bois. Pour démontrer que la représentation est à l’exacte mesure et proportion du Baptistère de Florence, l’architecte-peintre place un miroir à distance, entre la représentation et le bâtiment octogonal et symétrique. Si le reflet de la peinture, vu par l’observateur, regardant au dos de la tablette de bois superposée à l’édifice réel, se trouve à l’image du réel, la vérification se fait là où passent au présent des nuages sur l’argent bruni. Ainsi le miroir rectifie le champ de vision de l’observateur, donnant l’illusion d’une continuité parfaite malgré les bords de la tablette. Le champ de vision ne se clôt pas, il s’ouvre, il s’ouvre à l’infini. C’est le mouvement des nuages qui assure l’invention de la perspective. La merveille est dans le badigeon, l’expérience d’un espace réel par l’entremise de l’art. Comment s’étonner que cet espace soit resté la norme pendant cinq siècles. Or, ce qui est le plus mobile est le plus oublié du système, c’est le caché sous les yeux, les nuages. Ce mouvement, il faut l’appeler la morale de l’art : quelque chose se fait à travers quelque chose qui se défait. Les nuages transgressent des lignes droites convergentes. Il faut ainsi œuvrer pour remettre à l’endroit ce qui est à l’envers. « La provocation c’est remettre la réalité sur ses pieds », belle formule que laisse Brecht, à notre époque. L’économie nous a mis la tête en bas, et la politique nous la maintient sous l’eau. Il faut donc trouver le moyen de passer d’une contre-plongée à une plongée. Changer la représentation de l’espace, c’est changer la vision, et avec elle nos vies. Être en mouvement, cesser de conserver des places « quoi qu’il en coûte ».
Raison pour laquelle l’usage du mot « syndicat » n’est pas satisfaisant, et celui de « travailleur » paradoxalement romantique dans le contexte actuel. Les mots sont des pièges quand ils dessinent des histoires dont nous n’avons écrit aucune page. Ils accordent certes des places quand on les dit comme il faut dans la grande entreprise de normalisation : parler comme il faut, sans critique, toujours abstraitement avec un projet, un programme, des idées plein la tête, sagement alignées sur les opinions majoritaires, ressassées par les médias jusqu’à la nausée, et jamais d’alternative, jamais. Ne réveiller personne du rêve des mots, voilà le cauchemar ! Sauf que le présent mérite ses mots, et qu’il faut les arracher coûte que coûte à la mort de notre époque. Des mots déjà là, comme les nuages sur la tablette de bois de Brunelleschi, comme les mots de William Morris [2] : nous n’avons pas besoin de réforme, mais de révolution, au sens d’une entreprise de modification des fondations de la société. Il n’y a là aucune contradiction. Une révolution n’a pas d’autre mot que la coopération. Qu’est-ce que la coopération au-delà de sa forme horizontale ? Faire au présent, former l’agir sans tergiverser sur les idées, bonnes ou mauvaises, prenons-les pour ce qu’elles sont, des ruades. Il faut entrer par le milieu, de travers, n’importe comment s’il le faut, pour que notre appétit grandisse, que la table ne soit plus renversée comme les barrières dans les rues, que l’industrie culturelle s’assèche au lieu de nous engraisser virtuellement. Il faut en finir avec les mots « projet », « programme », parce que penser dans des mots qui ne sont pas ceux de l’art, c’est accepter qu’on dise aux artistes quoi faire, et encore comment. Un projet, un programme, c’est toujours la promesse d’une finalité, et après la promesse, l’apocalypse, et la ritournelle des nouvelles finalités, des nouveaux droits à conquérir sur la faim qui affame. Nous voulons reprendre la main, redevenir les artisans qui donne l’appétit aux alternatives, à ce qui peut l’être, simplement. Mais à une époque où règles et lois limitent les plus saines utopies, le présent est asphyxié. La pensée d’Ernst Bloch [3] est pourtant encore à notre portée, « Tout ce qui existe a son étoile utopique dans le sang ».
Si le mot de travailleur sert à manifester l’idée de lutte, alors il faut la nommer sans se tromper de temps ni d’ennemis. Quant au syndicat d’artistes et d’auteurs, qui est un regroupement d’individus en partage d’intérêts, aucun de ses membres ne pourra contester que des intérêts d’artistes ou d’auteurs, même en collectifs, sont des intérêts éclatés au sein de l’art et de la culture, comme on le voit à l’émergence de toutes les avant-gardes. S’il est invraisemblable qu’un groupe de citoyens ne puisse bénéficier de protections sociales, je persiste à dissocier le statut des personnes, leur demande légitime de droits, des moyens de travailler en tant qu’artistes et qu’auteurs.
Travailler à ne pas travailler comme les autres, cela signifie se libérer du travail en travaillant. Ça peut en agacer, il faudrait s’en réjouir. Se libérer du travail en travaillant ne se fait qu’au présent, là où est aussi possible la coopération de gestes sans dénomination. Car toute attention portée aux gestes conduit à se taire. Les artistes-auteurs ne sont pas au-dessus des autres, comme feignent de le croire les anciens occupants de la rue de Valois lorsqu’ils évoquent un New Deal de la culture. Le New Deal a d’abord été une façon de regarder le présent en face, en l’occurrence la misère, à preuve la part qu’y tiennent les photographies documentaires, comme celles de Dorothea Lange.
Les misères d’aujourd’hui ont le masque des illusions du progrès et de la prospérité, désormais défini comme la projection permanente de nos vies, incapables d’autres vies sous la menace d’une normalisation forcée. Chez les législateurs libéro-progressistes « va-t-en guerre des temps modernes », disait en prophète William Morris en 1884, qui voyait déjà en eux la relève des vieux conservateurs « qui ne jurent que par l’honneur et par la gloire et qui voyaient dans la guerre, à supposer qu’ils y vissent quelque chose, une bonne occasion d’étouffer les cendres de la démocratie ». Un syndicat d’artistes et d’auteurs vient naturellement s’objectiver dans ce contexte telles les séries de réparation réclamées à tour de bras et de unes de journaux, alors que la vulnérabilité et la solitude la plus enragée attendent des coopérations qui ne renoncent pas à l’humilité des gestes du quotidien. La réparation, autre mot de notre temps, ne dit la blessure que pour y mettre dessus un baume d’empathie. Mais empathie n’est pas appétit, tout au plus le dîner de ceux qui la dispensent. Pour réparation elle n’offre qu’une suture, autant dire un bâillon. Après le quart d’heure de célébrité, le quart d’heure de souffrance, et basta. L’appétit vient avec la faim de possibles. Ne jamais perdre de vue ce qui pourrait être, ferrailler sans cesse au lieu de regarder là où il n’y a rien plus rien à voir, du côté de l’économie à combattre jusqu’à l’épuisement, des clichés pour toute réalité, des mythes du passé comme si avait été perdue la capacité d’inventer. Je m’inquiète d’un syndicat d’artistes et d’auteurs, parce que je crains qu’après d’autres, réparateurs et programmateurs en tous genres fassent peser leur autorité sur une vulnérabilité que je ne suis pas prête à céder pour tout l’or, le confort et le placebo d’un monde comme celui-ci, même meilleur, c’est-à-dire pire dans la novlangue de l’époque. Faire en coopération et au présent, même si ce n’est rien, ou avec toute la colère qu’impose le travail de la faim en m’empêchant de faire mon métier, construire une parole, énoncer une position plutôt que penser à demain, pour faire de demain un avenir sans programme. Car dans un présent programmé aucune colère ne survit, et le présent même est un mot vide de substance. Docilité qui pointe depuis des années dans l’acceptation successive d’« états d’urgence », et maintenant dans une culture chez vous, devant la prison d’écrans quand elle vit DEHORS. La culture c’est ce qui nous fait sortir de chez nous pour regarder autrement. Il y aura toujours une différence entre des intérêts communs et une coopérative d’intérêts éclatés. L’entreprise de l’art est toujours, toujours, de travailler à un métier – non un emploi, ou une profession, mots d’une administration gestionnaire – dont l’établi est misérable. Qu’est-ce que ce misérable-là ? Notre présent, encore une fois ! Et qu’est-ce qui nous empêche d’en prendre possession pour que l’avenir soit possible, sinon ce que nous faisons au présent ?
Cela me renvoie à cette opinion encore qu’on entend à propos des artistes-auteurs, leur « invisibilité ». Certes on peut se demander pourquoi un syndicat n’a pas vu le jour avant, si tel était leur désir. On nous dit, d’autres le reconnaissent, ils sont individualistes. Je préfère utiliser le mot de solitude, que j’ai déjà employé. Ceci afin d’éviter des glissements sémantiques, sans parler d’euphémisation, si prolifique par les temps qui courent, parce que les artistes-auteurs, qu’ils se nomment ou pas travailleurs, travaillent toujours à la pointe du désir, du possible à ne pas confondre avec un manque de besoins concrets. Même associés, ils demeurent des solitudes, et pour une raison simple, c’est que la condition de leur travail ne peut être qu’excentrique et/ou excentré jusque et y compris entre pairs. Un syndicat d’artistes et d’auteurs est un nouveau symptôme de la centralisation et de la verticalité surtout lorsqu’il ostente un besoin de visibilité des artistes et des auteurs qui consonne avec la visibilité du marché, la visibilité de ceux qu’on interviewe dans les médias dominants. La visibilité du business. Ce qui me semble terrible, c’est que ceux qui s’organisent pour leurs droits aujourd’hui se qualifient d’invisibles, comme si c’était une tare, comme si l’invisibilité n’était pas aussi la puissance d’espaces intermédiaires, fussent-ils étroits comme un intercalaire, à l’heure du tout visible et de la toute transparence ! Comment cela peut-il nous satisfaire sinon de reconduire une situation famélique ? Pour plier sa force à celle de l’ouvrier, appartenir à une classe de lutte, alors que le présent nous somme d’inventer avec un travail qui n’est pas du travail. Comment retrouver les limites d’un langage, d’une parole, d’une position, et non une petite place à soi dans le langage propret, fonctionnel, de la communication, comme disait Victor Chklovski [4], assigné à une place dictée par le marché ? Comment inventer avec peu sans être pauvre, pour échapper aux stratégies financières ? Alors même que nombre de ces dits invisibles associent leur force à de simples citoyens pour créer des situations inattendues de collaboration, voire de coopération. Car la solution est là, notre présent c’est la misère qui donne de l’appétit à un travail libéré du travail, c’est par elle que tout commence. Parce que ça manque, il faut inventer sans avoir à se plier à la flexibilité du Capital dont la visibilité à outrance est le vice constitutif et la fascination.
A-t-on besoin de se montrer quand on existe ? Je parle ici du travail que l’on engage individuellement ou en groupe. La solitude avec laquelle on œuvre n’est-elle pas suffisante ? Si l’horizon utopique de la démocratie était dès le XIXème de rompre avec l’injustice de l’exploitation pour en faire l’état d’urgence et de guerre, il faut reprendre là où nous n’avons pas encore commencé, là où règne toujours un intolérable en cessant d’en être les héritiers bon an mal an, à quitter nos maisons et nos vies invivables pour créer des coopérations où chacun pourrait dire, on a fait un beau travail pour une époque qui n’en voulait pas. Notre pouvoir est sain, et nous n’avons pas eu besoin de nous emparer des pouvoirs législateurs, nous avions autre chose à faire, nous avons regardé les nuages, levé la tête. Ce sera là une révolution, non une énième réforme. Ce serait invention, non imitation. La peur doit changer de bord : votre misère gestionnaire ne nous fait plus peur, elle est la matière de notre bonheur, non notre affliction. Le travail commence par une coopération des colères.
Commençons :
« Et je chalumais dans mon chalumeau,
Le monde voulait dans son voulumeau.
M’obéissant, les astres roulaient en harmonieuse ronde.
Je chalumais dans mon chalumeau, fixant le destin du monde. »
Velimir Khlebnikov (1908)
Corinne Rondeau
Notes
[1] STAA, mai 2020. https://cnt-so.org/Lancement-du-Syndicat-des
[2] Penseur politique, artiste & artisan, fondateur du mouvement Arts & Crafts, et théoricien de l’Art Nouveau. Sa pensée est influencée par la théorie de l’interdépendance des arts de John Ruskin.
[3] Philosophe allemand, auteur du Principe espérance, rédigé entre 1938 et 1947.
[4] Écrivain russe et théoricien de la littérature.
Ce même texte est conjointement en ligne sur le site des éditions de l’éclat et de L’Arachnéen