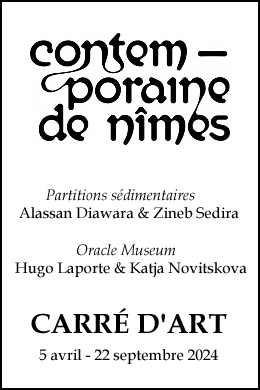La collection de Marin Karmitz à la maison rouge – Corinne Rondeau

À la recherche d’un corps
C’est avec l’image de la porte tambour de l’hôtel Atlantic du Dernier des hommes, film muet de Murnau, que s’ouvre l’exposition Étranger résident à la maison rouge. Trois cents œuvres de la collection de Marin Karmitz.
Passer l’image des vantaux en rotation, deux parallèles s’échouent au bout d’un premier long couloir sur un grand tirage de Gotthard Schuh. Un visage d’adolescent. Pas si adolescent d’avoir la gueule noircie des mineurs. Mais la beauté est certaine, la dignité et la grâce d’un port de tête haut et droit en trois-quarts ; un regard profond à l’éclat mélancolique ; une lèvre inférieure immaculée qui donne à l’image l’ombre d’un sourire.
Il faut pourtant résister à l’illusion d’une telle ombre, et rester immobile devant la première image d’André Kertész. Clope au bec, un juif d’un âge certain est assis au bord d’un quai de l’East River à New York en 1938. On le voit de dos. Parce que les vantaux produisent une force centrifuge, rien n’empêche de se rappeler que New York c’est d’abord Ellis Island. Entre 1892 et 1924, seize millions d’étrangers passèrent par « l’île des larmes », à raison de cinq à dix mille par jour. Deux à trois pour cent seulement sont refoulés. C’est ce qu’écrit Georges Perec au début de Récits d’Ellis Island, Histoires d’errance et d’espoir. En tournant les pages, comme la porte de l’hôtel Atlantic, des images repartent vers l’exposition : photographies d’exilés de Lewis Hine.
C’est plus qu’une collection que présente la maison rouge, plus qu’un autoportrait de Marin Karmitz en centaines de facettes, comme on le prétend.
Il y a de gros plans de visages sans nom. Des portraits embués, flous, tremblés, ceux de familles d’un siècle passé. Pas si passé que ça. Il y a une géographie d’Ouest en Est. Il y a des paysages de neige et de brumes. Des villes, des rues, des scènes de cafés, des chambres délabrées. Il y a des enfants, des vieux, des femmes, des hommes. Des silhouettes de dos et des mains sur la tête, ou devant le visage. Il y a quelques dessins, tableaux, sculptures.
Après la projection au sol de deux corps en pleine lumière plongés dans le sommeil (Sleepers d’Abbas Kiarostami, 2001) le spectateur pourrait penser que quelqu’un d’autre est en transit à ses côtés. Quelqu’un lui demandant de prendre le temps de traverser des histoires, d’observer comment le temps passe sur ces images fixes. Faire avec ce qui reste. Raconter un soleil d’hiver aux rayons laiteux au-dessus de promeneurs dans un sous-bois (Gotthard Schuh, 1932), ou les faibles éclats blancs de deux bouchons de bouteilles de ketchup (Roy DeCavara, 1952). À force de regarder les variations de gris, quelque chose pourrait arriver subitement, et d’un fracas crever les tympans. Étranger résident est une élégie faite d’élégance et de déchirures.
Il y a quelque chose qui tenaille le spectateur s’il ne veut pas rester dans l’empathie et s’il veut bien garder le silence que lui intime l’exposition : la profondeur des noirs, si denses autour des portraits tremblés de Michael Ackerman dans le premier couloir, ceux abandonnés de Roman Vishniac après lui.
La profondeur n’absorbe pas seulement la vision, elle la noie. On sent sur la poitrine une pression, avec pour tout réconfort le sourire discret d’un visage sans identité, celui de L’inconnue de la Seine en plâtre jaunie de Man Ray, masque d’une mort dont on ignore tout.
La profondeur des noirs est justement l’ombre d’un corps qui n’est pas là, brûlure à même la pellicule. C’est l’espace inversé de l’argentique, une expérience du négatif comme la blancheur impossible de la lèvre inférieure du jeune mineur. Le noir pèse sur la vision, mais ne s’attrape pas. Exactement à l’image du second couloir, organisé par une suite de sept cellules, qui n’est pas une simple perspective, mais un espace qui contient un espace autre qui continue, le temps lui-même.
Entre la discrétion et l’ombre d’un sourire, il y a un corps qu’on cherche avec le nôtre, dans tous les sens, coins et recoins. Partout et nulle part. Puis tombent sur le dernier mur les mots de Owls at Noon de Chris Marker : « Rappelez-vous de l’homme invisible ». L’homme qui n’a pas d’ombre affole l’espace. L’homme qu’aucun objectif ne peut capter et sur qui la lumière n’a pas de prise. La photographie argentique n’est pas qu’une trace. Chaque fois elle montre l’impuissance de la lumière à traverser un corps. L’opacité même. Ça peut être lourd comme une sculpture. Peut-être que le collectionneur a besoin de lester son propre corps, un peu à l’image de la sculpture de Panamarenko dans le patio dont on hésite à dire si le personnage atterrit ou s’envole.
Étranger résident est le fantôme d’un monde perdu, derrière nous. Mais qui peut s’opposer au fait qu’il n’est pas aussi devant, qu’il ne forme pas les ombres collées à nos basques ? La puissance des images de l’exposition vient aussi de l’impuissance contemporaine à garder le silence, et l’humilité face à ce qui a été perdu et que l’on répète du vieux slogan de la première guerre mondiale : « Plus jamais ça ! ». On peut parier qu’on n’a pas fini de l’user. Tourne la porte tambour comme pour tordre les mots d’ordre et nous convier à penser que depuis un siècle c’est toujours ça. Penser ça et en faire quelque chose. C’est la légion d’hommes de dos dans la collection de Marin Karmitz qui l’affirme le mieux. Ils ne sont pas la figure romantique du promeneur solitaire qui prenait imaginairement notre place d’une silhouette oblitérant la vision. Possible que l’empêchement soit devenu le mode défensif et privilégié de notre actualité : on ne se tient plus que contractuellement devant les hommes, et cela avec une telle défaillance que le monde en est contaminé. Vision rutilante d’aveuglement comme les lunettes d’un ouvrier d’Eugene Smith, ou les deux sphères posées sur les yeux de Jorge Molder, la tête sur un oreiller tel un mort. Depuis le XXème siècle, les guerres nous ont appris à tourner le dos. Mais peut-être que lunettes et sphères sont aussi une alternative : se retourner en soi, anticiper la mort comme une vie intérieure. Faire corps avec une énigme.
Si nous ne tremblons pas devant le temps, si notre vision n’a plus rien d’une inquiétude, et le mouvement plus rien d’une étrangeté, nous ne sentirons plus l’appel d’un fantôme, le souvenir impossible de l’homme invisible, le sourire du dernier portrait.
Il faut se hâter d’aller voir Étranger résident. Se hâter non parce que nous allons mourir, mais pour vivre, regarder la vie en face.
Corinne Rondeau
Étranger résident
La collection Marin Karmitz
15 octobre 2017 – 21 janvier 2018
la maison rouge
10 boulevard de la Bastille – Paris (12e)