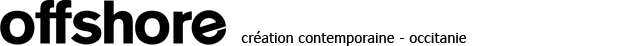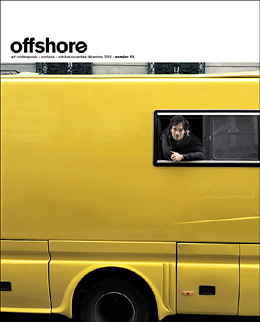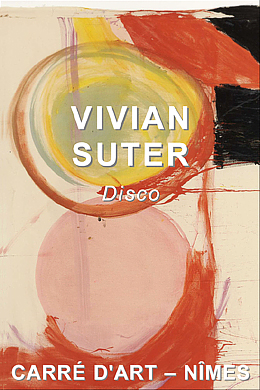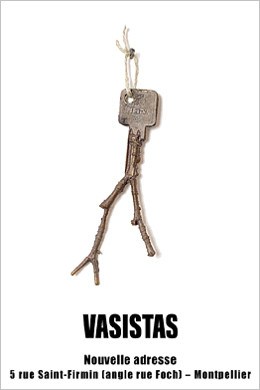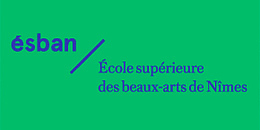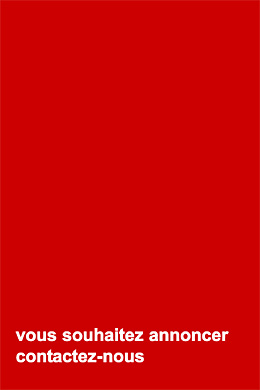Kartoffelschnaps – Corinne Rondeau
Si l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, souvenons-nous que pour les alchimistes du Moyen Âge, Schnaps signifie eau qui redonne vie ou la prolonge. Sigmar Polke n’a pas lésiné à faire éclater la vie jusqu’à éclabousser notre triste présent. L’exposition qui va bientôt s’achever à la Fondation Van Gogh d’Arles, Sous les pavés, la terre, lui rend hommage dans un accrochage en forme de balle de flipper : rebonds incessants comme des patates à déterrer dans chaque recoin pour alimenter l’alambic ;
humour piquant ou potache ; dose d’érotisme pas piqué des hannetons. Ébouriffante, fraîche, intempestive, autant de qualificatifs pour une production détrônant sur son passage à peu près tout
des soixante dernières années.
Prodige à élargir le champ de l’art, non à cause d’une consommation régulière de champignons hallucinogènes, ou de l’usage de poisons chimiques en tout genre, Polke a libéré peinture et photographie, voire l’esprit. Faire de l’art c’est reconnaître « nécessité et utilité » et surtout éviter que l’art soit
« inoffensif ». Rien n’est plus redoutable que la vie pour démonter les catégories, et toute chose à leur place avec une étiquette estampillant le prix. Évidemment l’art a un coût, mais c’est aussi un machin bizarre, surprenant, inquiet, un brin insomniaque, hors système. Quelque chose qui sollicite les sens au lieu de chercher à lire des significations dans l’air du temps. Des yeux qui bougent dans tous les sens, pas des yeux qui suivent en ligne droite le discours explicatif.
Lorsque Bice Curiger lui demande en 1985 si le temps s’arrête dans la peinture ? Polke répond du tac-au-tac « pas dans les miennes ! ». Il proposait même de les regarder « très vite », de les « prendre avec soi au lit », de « les embrasser ou de les piétiner ». Y a des nerfs, du muscle, des humeurs et des rires, bref des échanges d’affects. Et si on en manque, faut ouvrir grand les chakras pour avoir une chance de transformer une perception en sensation. Libérer signifie « vivre quelque chose qui a été retenu », « sauver quelque chose de vies ratées ». La plus parfaite des images de la vie est une image imparfaite. Toutes les vies valent la peine qu’on les regarde, c’est ce que fait l’aventurier Polke en utilisant toutes les sources possibles de la reproductibilité et des vieilles choses faites à la main, de toutes sortes, de tout temps, en tout point du globe.
Sur la surface au rendu peu net, parfois sale, dont on repère des gouttes de chimie ici, de grands et petits gestes libres là, des découpes de traviole, tout fait corps. Du corps au turbin, un peu à la Van Gogh qui, en 1880, voulait peindre moins des paysans que les paysans et la terre qu’ils ensemencent. Souhaitant
« creuser profondément dans la vie », le point de vue du néerlandais était la terre, un truc dur ou boueux selon la météo, qui accueille notre séjour de vivant, non un sujet réaliste de la vie agricole. C’est d’une autre surface que Polke organise son point de vue kaléidoscopique et sa vie sur terre. Photos solarisées ou pâlies par absence travaillée de contrastes. Photos montées avec plusieurs expositions de négatifs foutant un grand bordel spatial, mettant en péril la reconnaissance du sujet. Toute cette quincaillerie dit une chose au regard : approche-toi si tu peux, même s’il n’est pas sûr que tu aies quelque chose à en dire, à l’image de la vie de tous les jours. Alors au bout d’un certain temps comme un brouillard qui se lève ou bien parce qu’on a appris à sentir et à marcher dans une purée de pois, se lève la vie dans la vie de l’image. Série Paris 1971, un imbroglio de plans où le centre est un grand sourire sur un visage de femme sur un quai de métro. Alors que les voiles de révélateur produits par superpositions de photogrammes enveloppent cette joie entre une main sur un sein et des petites lucarnes de couple enlacé placées à l’horizontale, toute l’image composée résonne d’intime. L’intime est sur un quai de métro, à la place de la Concorde, sur le pont de l’Alma… l’intime, couches de temps, dépôt des corps dans tous les sens des affects, rire, toucher, enlacer, marcher… et d’autres choses encore absentes à la surface qui remplissent la mémoire. Miracle du négatif avec lequel des variations sont infinies, et dégage la réalité capturée et captive d’un cadrage.
Chez Polke tout est en mouvement perpétuel, ça déborde, ça exagère. Parce qu’il y a une folie chez lui, la folie d’une grammaire on pourrait dire. Dans De l’éloquence en langue vulgaire, Dante expose la possibilité d’une langue nouvelle, « naturelle » en unifiant les parlers multiples de l’Italie, ce sera celle de La Divine Comédie. C’est un projet inouï depuis le XIVème siècle qui ne doit pas nous laisser en paix, ni au petit bonheur du confort moderne : « l’homme est l’animal le plus instable et le plus enclin à la variation ». Polke est cet animal insaisissable. Sa singularité est un universel où tout y passe de la fascination du grand art au point d’y regarder ses dessous (Goya), aux défigurations entamées par la modernité (Ernst), ou de ce qu’on nomme par paresse Pop, quand il est question d’expérimentation dans le vortex du temps de l’art et de la vie, unifiant images publicitaires, gravures du XIXème siècle, iconographie du Moyen Âge et de la Révolution française, formes défigurées à la photocopieuse, sels d’uranium, résine synthétique, feuilles d’or et mauvais goût et Cie : popote à Polke.
Libérer est le maître-mot : se libérer du passé avec le passé ; libérer l’avenir de l’art contre tout ce qui pourrait le défigurer en dehors de lui, trouver ses sortilèges de l’intérieur en exerçant une violence appropriée à son imagination avec tous les artifices techniques et les réactions chimiques à disposition pour la stimuler. Geste génial : se libérer de la culture, qui a la fâcheuse tendance à sauter sur tout ce qui bouge, c’est-à-dire sur nous. La culture si on regarde de près est devenue une entreprise de thanatopraxie qui a annexé l’art. Lorsque en 1976 à Palerme, Polke photographie dans les catacombes, ce ne sont pas des squelettes mais des êtres entre deux états, dans une mise en scène qu’il n’a pas choisie, simplement saisie. Crâne avec un peu de cuir chevelu restant, un clope au bec, costard encore non mité et foulard noué, œil tombant hors de l’orbite… c’est autrement sale, mais ça dit une autre chose : le contenu de la photo tirée est toujours latent car la vie est toujours en action. Les photos de Palerme ne sont pas morbides, ne sont pas le culte de la mort à l’air libre sicilien. C’est un éclat de rire faustien. Polke est impénétrable si la vie nous a fui, si on a offensé le désir le plus vital, la pensée la plus bâtarde, la beauté la plus légère.
Celui qui est venu de l’Est de la guerre froide et de la lumière nous déterre de la paralysie générale. De la photographie au vitrail qu’il pratique avant de faire des études à Düsseldorf, il offre une apothéose dans un cycle d’une érudition sans pareille à la Grossmünster de Zürich à la fin de sa vie. Polke est un atome de lumière, matière aussi insaisissable et variable que lui, il a percuté toutes choses pour les arracher à l’inertie. C’est par ses rebonds, à l’image de l’exposition, que se mesurent sa vitalité indestructible, sa présence marginale… car comme le disait Jean-Luc Godard, « la marge c’est ce qui tient la page » !
Corinne Rondeau

Sigmar Polke, Sous les pavés, la terre
Jusqu’au 26 octobre
Fondation Vincent van Gogh
35 ter, rue du Docteur-Fanton
13200 Arles