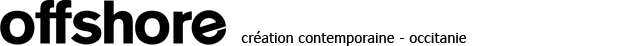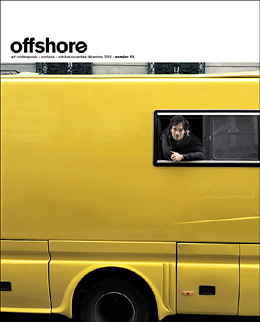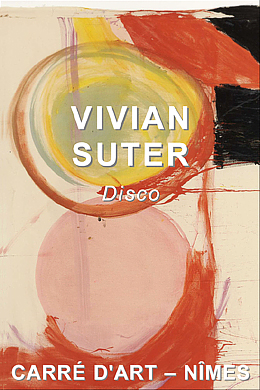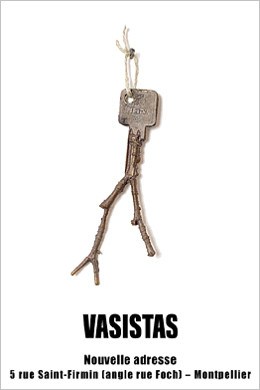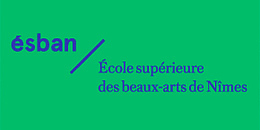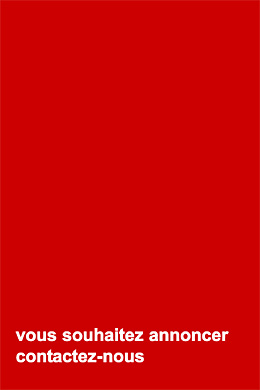« Disco késako » par Corinne Rondeau — Vivian Suter à Carré d’Art, Nîmes

Il est coutume de sortir d’une exposition sans avoir rien à en dire, plus rare la sensation d’un pas grand-chose à exprimer de la première importance. C’est le cas de l’exposition Disco de Vivian Suter à Carré d’Art. La plupart du temps, on se rassure de quelques références historiques qui font écho à un regard borné qui n’invitent pas à s’aventurer ni à se risquer au-delà des formes ou de concepts déjà exprimés.
Disco, le titre laisse perplexe. Est-ce la boîte de nuit dans laquelle on s’engouffre pour vivre avec nos corps un environnement conçu pour éprouver des sensations physiques, ou bien vient-il d’un lointain latin qui signifie « j’apprends » ? Peut-être un peu des deux : apprendre des sensations, et en l’espèce apprendre à voir dans une forêt de toiles.
Disco késako ? C’est d’abord le nom d’un de ses chiens, et aussi une profusion de toiles grand format, environ quatre cents œuvres accrochées, superposées, suspendues, entassées sans aucun mur vierge.
Le mot choisi pour communiquer est celui d’« immersif ». Or cela nous empêche de penser ce qu’est être dans un milieu, dans un lieu qui dénature le lieu d’accueil. Nous ne sommes plus dans un musée, mais dans autre chose. Serait-ce une intériorité, un dedans qui par nature est toujours habité par un dehors ? Inutile de sortir des idées compliquées et d’user d’une rhétorique qui ressemble souvent à un engluement théorique. Ce dedans, et c’est vraiment la sensation qu’on vit dans l’exposition sans aucun artifice, vient d’un événement qui sera pour Vivian Suter un véritable tournant, autant que la grandeur surhumaine que distille l’accrochage. En 2005 alors qu’elle est installée au Guatemala, l’ouragan Stan détruit son atelier où elle conserve ses toiles et principalement peint. Boue et eau ont fait leur œuvre de destruction et de recouvrement. C’est dehors qu’elle entendra peindre et dont la surface accueille désormais tout ce qui entre en contact avec elle, empreintes de chiens et d’oiseaux, brindilles, poussière… Ce dehors n’est rien d’autre que la conscience d’une puissance contre laquelle il serait irraisonnable de construire un bunker, davantage la transférer à soi. La puissance de la nature est comme passée dans la pratique continue, ouverte par un geste confronté à une surface avec des couleurs. Le transfert de la puissance n’est rien d’autre qu’une rencontre indéterminée et, compte tenu de la prolifération des toiles, infinie. Ça arrive comme un vent qui se lève violemment après une légère brise. Ainsi l’événement du dépouillement et l’acceptation de la vulnérabilité par une force colossale renvoient à ce qui me semble de la plus haute importance : faire de notre existence un récit.
Sans doute Vivian Suter, qui parle peu dans un filet de voix, accepte le terme de « paysage » pour définir son travail, mais sommes-nous vraiment devant ou dans un paysage parce qu’on voit de supposés troncs d’arbres, une floraison de couleurs ou parce que les toiles suspendues à des racks jouent un ramage à travers lequel vibre la lumière ? La réponse est négative, nous sommes face à ce qui demeure : à voir le nombre de formes circulaires qui reviennent de toile en toile, cela saute aux yeux, elles sont à la taille de son corps, à la longueur de son bras selon que son angle est grand ou petit. À chaque fois c’est ce corps qui revient avec des cercles, des coulures, des lignes. Ce qui demeure est un geste humain qui n’est pas moins puissance de pouvoir tout mettre en vrac et de n’avoir rien à faire du haut et du bas de l’œuvre. C’est une puissance qui rappelle la phrase de Paul Valéry « il faut se proposer un but impossible » au même titre que les dégâts d’un ouragan : c’est phénoménal ! Il faut l’entendre selon une langue intellectuelle et une autre vulgaire. C’est une phénoménologie qui convoque une expérience vécue de la perception, et l’injonction d’une apparition remarquable et unique. Peu importe en définitive l’importance de la trouvaille dite picturale, ce qui compte c’est la difficulté vaincue qui se manifeste par trois principes : pas de titre, pas de date, pas de sens d’accrochage. Rien ne peut empêcher d’apprendre à voir dans tous les sens, hors des sentiers rebattus de la connaissance. Cette difficulté vaincue est une liberté. Sans doute la cherchons-nous toujours avec beaucoup d’insistance, et se fait grosse de notre impuissance à l’appeler. Mais on se souviendra qu’elle ne se conquiert que contre ce qui la nie, et qu’une fois vécue on ne l’oublie plus. C’est cela le geste de Vivian Suter qui se transfère en action pour le spectateur : ce qu’il perçoit sans certitude du sens, de représentation, de reconnaissance, c’est qu’il est infiniment pris par la liberté d’une puissance dont il n’aura pas assez de plusieurs mots pour la définir.
La liberté n’est qu’une action à l’image d’un mot, coupé en deux, peint sur une toile « ABSTR-ACTION ». On peut y lire un second à l’autre bout de l’exposition à côté d’un acronyme « WHWA MAKES ». Faire une action, ce n’est pas d’expressionnisme dont il est question, mais de l’expression que Spinoza utilisait « pour exposer la puissance ». L’expression n’est pas création, c’est d’abord s’arracher à des passions tristes. Dans l’exposition quelque chose nous retient dans ce sens dessous-dessus sans nous attacher, sans nous dominer même si l’exposition est colossale, sans porter un seul jugement.
L’art de Vivian Suter est dégagé de tout commentaire et de toute actualité. Pas même une prétention écologique. Et si on se demande si c’est de l’art, je répondrais que ça en est la quintessence du présent : qu’est-ce qui reste du chaos ? Un geste humain qui est une joie. Et si on se dit qu’il n’y a là qu’accumulation, je répondrais encore qu’il y a quelque chose d’incommensurable qui rend caduque une telle affirmation. La chance que nous donne cette œuvre proliférante, c’est de perdre le privilège du sens. Ce que le spectateur cherche de connaissance est vain. Cela devrait l’enthousiasmer au plus haut point. Ne pas trouver du sens ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’art, au contraire. Car l’impuissance du spectateur ou du critique est une réponse à la puissance aux airs beckettiens : « quoi qu’il cherche ce n’est pas ça ». Car si on trouvait tout serait brisé, mort. C’est pour cette unique raison que la puissance de l’humain est comparable à celle de la nature, et qu’on ne peut la mépriser, comme on regarde en souriant, des formes folkloriques avec ses rites de passage les plus farfelus qui soient. On ne sait plus d’où ça vient mais ça danse, ça chante, ça fait du commun, ça se répète à travers le temps. C’est exactement le même problème quand on se pose la question de la présence des collages de sa mère dans son exposition, l’artiste Elisabeth Wild. Il faut la penser comme une origine que Vivian Suter a tiré de la même façon que l’ouragan. Nous provenons tous d’une enfance et nous sommes sous la coupe d’événements remarquables et uniques. C’est là que se loge la puissance comme des possibilités en germe. Ce que la mère comme l’ouragan ont laissé à la fille-femme-artiste ce sont des moments qui ont rendu possible le monde. Il peut être cruel, tout fracassé, nous laisser triste d’un deuil, mais il a aussi un revers joyeux : tout ce qu’il donne ébranle notre existence et transforme notre conscience pour montrer, raconter d’une façon radicalement nouvelle ce que nous sommes au monde. C’est aussi ce qui arrive au spectateur mais alors il n’a rien à dire. Action !
Corinne Rondeau

Carré d’Art – Musée d’art contemporain, Nîmes (30)
Disco
Vivian Suter
8 novembre 2025 – 29 mars 2026