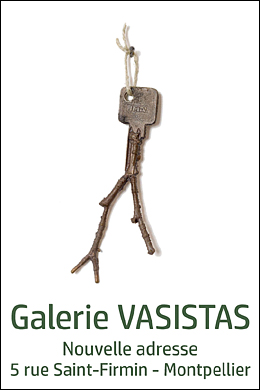Festival Montpellier Danse 2016, fin et bilan – And the winner is …

Les derniers spectacles
Au delà d’une possible intrinsèque théâtralité, les dernières pièces du programme ont joué d’une théâtralisation jusqu’à dérouler des compositions en tableaux voire d’une « théâtreusation » en numéros et jusqu’à une « café-théâtrisation » en sketchs. Evidemment, si écrire n’est que scénariser, cela peut être une solution. Tout ce que l’on redoute !
Au contraire des effets de « surprise » même jolis ou de rires racoleurs, nous espérons juste nous perdre face à ce que l’on « voit » et être donc Ailleurs, en grâce.
Tout en attention, Salia Sanou œuvre pour que les hommes et les corps s’élèvent. Le « s » du titre de la pièce est en soi un manifeste, signant ses ambitions.
« Du désir d’horizons » évite les nombreux écueils du rude sujet des réfugiés – de leur étant comme de leurs états. Il souhaitait « poser les choses vues », disait-il, avec un engagement traduit en « contribution ». Cet objectif là est largement atteint. Le poétique est le propre de l’homme, aurait-il pu même ajouter. Mais la narration a dû prévaloir à la chorégraphie lors de l’écriture et à la suralimenter, l’auteur y cède le temps nécessaire à la radiation de moments de beauté – tel la déconstruction jusqu’à son hybridation africanisée d’un sirtaki sur des sons parvenus des rives voisines et convoitées – s’obligeant à enchaîner tableau sur tableau. On regrettera alors, quand la théâtralisation, phagocytant la théâtralité, nous cloue au concret d’un scénario saturé, nous empêchant de nous élever nous aussi. Et avec eux.
La Zat au Corum ou comment Dimitris Papaioannou dit travailler la perception.
Pour sûr, on perçoit ses intentions. Longuement et lentement, comme si la durée était rampe d’accès, un volontarisme d’une idée de « poésie » – pour qui n’en aurait jamais lu – s’acharne autoritairement à vouloir nous bouleverser en enchaînant numéro après numéro tous les « trucs » les plus laborieux et convenus du divertissement, propres à activer nos sensations primaires et non nos sens. Pas de chance pour nous, façonnés par la Vanité et toujours bouche bée à l’apparition de la fugace brillance d’une étoile filante.
Le sentiment critique est-il bien utile quand l’objet examiné est réponse à un casse-tête de programmateur ? Et le chaleureux accueil du public réservé au spectacle n’aide en rien à rester concentré sur la vraie problématique, bien au contraire : le festival côté Corum est-il définitivement un festival « parallèle » avec obligation d’occuper ses trop nombreux sièges et d’y adapter une programmation qui serait réponse à une attente ? Cela ne ferait qu’augmenter l’écart entre qui vient vérifier et qui désire s’aventurer. Le spectacle pour tous versus l’art pour le plus grand nombre, once again. Si, et pas qu’à Montpellier, et même moins qu’ailleurs, la position d’une dite responsabilité politique est sans surprise, la problématique – agitant deux options qui ne doivent pas se combattre mais à tenter de poser en équation, qui, elle, n’est pas prête d’être résolue, n’y peut-être à résoudre – reste à penser assurément.
On arrive enfin, ces tout derniers jours, aux premiers dégâts occasionnés par la fusion des deux ex-Régions avec l’invitation lancée au toulousain Pierre Rigal qui y a répondu, nous laissant cois. Quoi ? COIS !
« Jt’aurais présenté une mousse comme ça moi, même en camping, tu m’la foutais sur la figure » jouait Sylvie Joly dans son sketch « L’après-dîner ».
Bien seul
Quant à nombre de solos qui ont ponctué cette 36e édition, l’exercice des mythologies personnelles n’arrive à atteindre d’universalistes résonances.
On pense alors à Radhouane El Meddeb, dont la pièce était justement construite malgré une scénographie dramatisante – cartographie inachevée en tapis de sol et carcasse animale en contre-point – qui dit « aimer être seul sur scène et l’assumer ». Assumer quoi ? Rester dos au public pour mieux traiter d’un acte manqué, en tête-à-tête avec le défunt père ? Malgré la chorégraphie, le solo devient alors soliloque.
Hooman Sharifi, lui, veut tout nous dire de lui. Par les mots, les sons, les objets et le corps. La générosité, comme la danse, est débordante alors que le dispositif lumineux – des plus réussis – accompagné des musiciens, aurait suffit pour produire mouvements, et les partager peut-être jusqu’à l’hypnose. Mais oui !
Albert Ibokwe Khoza, sous la houlette de Robyn Orlin, nous amena au cabaret. Tout l’enjeu de ce genre est d’en rencontrer son public. Au music-hall, la portée politique distillée par Joséphine Baker dans la « Revue nègre », il y a plus de 90 ans, aussi nue qu’Albert mais avec bananes en place d’oranges, fut autrement risquée et opérante.
Dans un autre registre, Ali Moini, exhibe et se trouve pris dans un dispositif archaïque, décoratif et alambiqué qui le relie à « un double », dit-il, un squelette approximatif de marionnette en fait. Suspendu, il aurait pu creuser élévation et gravitation. Mais la chorégraphie n’est pas faite pour elle-même mais pour l’autre, en métal, à côté, et qui n’est personne. Et on ne s’étendra pas sur le long passage de « l’alouette sans tête »…
Un travail encore jeune mais subtil a néanmoins réussi à nous capter : Sorour Darabi, entre sur un plateau en dispositif rébarbatif de conférence – 1 table, 1 chaise et une pile épaisse de documents – et déjoue notre crainte d’ennui en jouant, elle, de métaphoriques malformations supposées congénitales entraînant maladresses qui empêchent de lire et dire ce qui devait être délivré ; les mots sont alors ravalés. Nos a priori – puisque avouons-le, nous en avions – aussi.
Conférence de Presse Bilan du vendredi 8 juillet
Une rencontre des plus déprimantes ce matin. Tout ce que l’on craignait d’entendre a été dit ; d’un côté de l’estrade comme de l’autre. On notera les interventions claires de Hussein Bourgi, représentant la Région, qui ne s’est pas privé d’une rafraîchissante subjectivité et même curieux, se posant la bonne question à propos de Jean-Paul Montanari et la confusion fabriquée autour de l’idée de repenser le et/ou les festivals : « Que veut-il nous dire ? ».
Mais oui, il faut l’entendre plutôt que comme il a été plus ou moins décidé, de « rester ouvert à la discussion, se réunir et de réfléchir… », ou aussi pire, se penser expert et détenir les solutions. Là encore, pas de solution car pas de problème. En revanche, réflexion puisque apparaît une problématique. A moins que l’on se croît condamné à ce que tout, nous et notre monde, reste figé.
Si Montanari concède de plus en plus de gentillesse – le flirt avec la sérénité aidant – il s’exaspère de toute médiocrité. Et, pour rejoindre la pensée sur le théâtre, « Et là, c’est le drame ! ». Pas sur scène ni sur l’estrade mais dans sa tête et nos esprits.
Evidemment rien n’est figé, et la danse continue et à Arles, qui, bénéficiant déjà d’un formidable attrait touristique, s’annonce comme future capitale artistique du Sud de la France avec l’ouverture prévue en 2018 de la Fondation Luma de Maja Hoffmann.
Cette puissante et ambitieuse Fondation – à l’occasion du lancement de son nouveau partenariat pour les 3 ans à venir avec le LA Dance Projet – présente des soirées exceptionnelles jusqu’au 13 juillet et trois supplémentaires du 23 au 25 septembre 2016, dans le bâtiment rénové de la Mécanique Générale.
Au programme :
Benjamin Millepied présente « Hearts & Arrows » sur le Quatuor à cordes n°3 Mishima de Philip Glass et un concept visuel de Liam Gillick
« Helix », chorégraphie de Justin Peck – musique d’Esa-Pekka Salonen
« MinEvent », chorégraphie de Merce Cunningham – musique de John Cage
Les « Caviar » de Montpellier Danse 2016
En suite donc aux quelques solos – égocentrés – vus, moi aussi je me suis réuni et avons délibéré.
Il ne s’agit pas de j’aime, j’aime pas. Qu’est-ce que je fais et qui suis-je face à une œuvre, ne sont pas des questions que je me pose mais des questions qui se posent à moi.
Meilleure Musique à Christian Rizzo pour « Le syndrome Ian »
Meilleure Lumière à Emanuel Gat pour « Sunny »
Meilleurs Costumes non attribué
Meilleure Scénographie à Christian Rizzo pour « Le syndrome Ian »
Prix du Public à la compagnie Le Patin Libre pour « Vertical Influences »
Prix de la Critique à Lia Rodrigues pour « Para que o céu não caia »
Prix spécial du Jury à Nacera Belaza pour « Sur le fil »
Grand Prix du Jury au Cullbergbaletten & Deborah Hay pour « Figure a Sea »
Et Baba le dit, n’oublions pas que la danse, c’est que de la… DANSE !
Jean-Paul Guarino