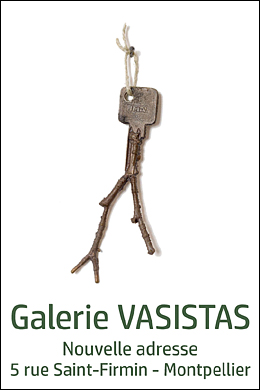C’est la fin du printemps, l’été enfin ! Ça ira… de Pommerat – Marie Reverdy

Que pourrions-nous dire de plus que le « ça ira » que Louis XVI, sûr de sa stratégie politique, prononçait, dans un optimisme béat à la fin de la pièce de Joël Pommerat. Ainsi en allait-t-il du titre d’ailleurs, qui prend, une fois n’est pas coutume, le mot « fin » dans son sens propre et auto-réflexif : « Ça ira (1) fin de Louis ». Car il n’y avait pas d’erreur possible, nous étions au théâtre, face à une fiction documentée, assis dans le public lui-même fictionnalisé en membre de l’Assemblée nationale. L’emphase utopique nous portait, nourrit que nous sommes au lait de la révolution française, mère de la démocratie et de la République. Seulement voilà, la pièce rappelle bien vite à notre bon souvenir que la révolution portait également en germe un empire à venir, comme réponse à la terreur. Les positions se durcissent, se sclérosent, on retourne sa veste ou son bonnet phrygien. La dimension fictionnelle peut, en effet, nous faire éprouver l’Histoire ; non pas nous l’expliquer par les dates marquantes, mais bien nous aider à la comprendre par l’univers axiologique qui animait nos ancêtres, nous permettre de nous approprier et de vivre les contradictions, les difficultés, les paradoxes, l’espoir et la peur.
C’est à Wilhem Dilthey que l’on doit la distinction entre « comprendre » et « expliquer ». Si l’Histoire ne saurait se contenter d’une explication par des causes, c’est que le fait humain échappe aux lois déterministes. L’imprévisibilité inhérente à la l’action humaine nous interdirait, en effet, de penser l’Histoire selon les termes de la cause et de la conséquence, au risque que son exercice soit idéologique, car construit sur un présupposé quant à la nature de l’action humaine et à la prévisibilité des faits. Le fait humain n’est pas pour autant toujours intentionnel. Il est également affectif, bourré d’adrénaline qui peut forcer la rage combattive où la fine stratégie de la fuite.
Le système de représentation peut alors nous donner à voir les émotions qui pouvaient, éventuellement, faire agir les actants de la révolution. Confinant néanmoins ceux-ci dans les arcanes du passé, malgré les ressemblances notables avec notre situation présente. Le roman ou le cinéma historique fonctionnent nécessairement ainsi. Le théâtre, art de la présence par excellence, peut proposer une dimension supplémentaire. Imaginons que nous nous soyons mis à applaudir, dans l’assistance, les discours des membres de l’Assemblée, ainsi que la répartition des comédiens et figurants dans les gradins semblait nous inviter à le faire : que ce serait-il passé de plus ? Au début nous aurions applaudi, rondement même, à toutes interventions ou presque. Puis nous aurions commencé à douter, certains intervenants se déclarant plus ou moins de droite, plus ou moins de gauche, plus ou moins enclin à la terreur, plus ou moins capables de justifier les moyens par les fins, ou exerçant plus ou moins, in fine, le débat démocratique de manière politicienne, voire politicarde. Nous aurions alors, effrayés par nous-même, applaudi à ce que l’on ne saurait, rétrospectivement, cautionner. Nous aurions eu du mal à applaudir certaines interventions que certains de nos voisins auraient applaudi, nous nous serions regardés chiens de faïence, nous abstenir d’applaudir serait devenu un acte de contestation. Nous aurions quitté la place du spectateur traditionnel qui, loin d’être passif, se croit toujours « invisible ». Nous serions alors devenus, pour paraphraser Merleau-Ponty, des « voyants visibles », légèrement mal à l’aise, légèrement coincés dans les couloirs de l’Histoire et des évènements, légèrement enclins à vouloir déserter l’Assemblée pour boire un vin chaud, puis revenir, refuser qu’il puisse y avoir deux entractes pour favoriser l’esthétique de la fuite au détriment de celle de la pause. L’inaction serait devenue, tout comme l’action, le résultat d’un choix que nous aurions peu ou prou maîtrisé par l’exercice de la raison. Nous n’aurions pas débattu, certes, mais la présence de notre corps se serait faite pesante, nous ramenant, chacun, à nous souvenir que nous existons et que nous sommes, qu’on le veuille ou non, embarqués dans le torrent du temps. Torrent dont le lit rempli de cailloux n’est pas fait pour nous conduire vers une destination certaine, mais dont la force du courant se pense en fonction des évènements qui le constituent, nous ordonnant de choisir entre nager jusqu’à épuisement ou nous laisser emporter jusqu’à l’accident.
Marie Reverdy
Ça ira (1) fin de Louis de Joël Pommerat
donné au Printemps des Comédiens, Montpellier les 19 et 20 juin 2016