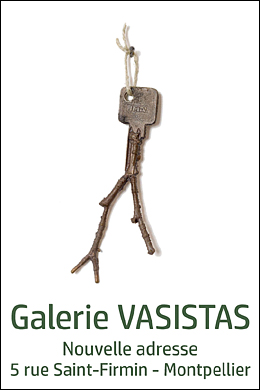Dominique Gonzalez-Foerster au Centre Pompidou – Corinne Rondeau
Éloge de la moquette
Je me souviens d’Expodrome, l’exposition de Dominique Gonzalez-Foerster au MAMVP en 2007. J’avais aimé l’espace qui plaçait le vide en son centre. On prenait le temps de sentir une fêlure, l’expérience d’un rien à laisser filer, un espace-temps à notre mesure. Même celui qui pouvait être contrarié — du rien, du vide — ne pouvait ne pas être confronté à ses propres attentes. Finalement, ça tournait autour de notre désir propre. C’était une grande ligne horizontale qu’on s’abandonnait à suivre, à s’asseoir, à revenir en arrière, à avancer, à sortir sans sortir, à se perdre pour se retrouver.
2015, Centre Georges Pompidou. L’artiste française de renommée internationale (je me souviens encore d’un petit film fragile présenté à la Biennale de Venise en 2009) expose 1887-2058. Les espaces ne sont plus des environnements qui, en 2007, avaient la pertinence discrète de nous faire sentir ce qu’il peut y avoir d’illusion et d’illusoire dans une exposition. Le visiteur n’est plus le milieu, l’étrange commencement où se forme un départ avec sa formule simple « il y a » soudainement quelque chose. Fini le temps où Dominique Gonzalez-Foerster faisait de nous un possible de l’art dans la pauvreté même de notre expérience, de notre ignorance. Aujourd’hui, la boucle se referme sur Dominique Gonzalez-Foerster herself, à peine masquée derrière une citation d’Enrique Vila-Matas, juste avant d’entrer dans la Galerie Sud. Je ne la reproduirai pas. La reproduire ce serait s’enchaîner à la mise en série de citations, de références et de renvois qu’elle amorce par le nom d’un autre écrivain, Rimbaud, et qui fournit à l’exposition son propos récurrent : s’exposer.
Première citation, et embrayeur de toutes les citations à venir, qui sont autant de masques de l’artiste qui apparaît en Lola Montès de Max Ophüls. En Marylin Monroe dans la piscine du film inachevé Something’s Got to Give. En Catherine Deneuve dans Belle de Jour. En Klaus Kinski dans Fitzcarraldo de Herzog. Ses vêtements accrochés en forme d’autobiographie. Son livre, 1887, Splendide Hotel, pendant à des rocking-chairs au bout d’une chaîne de métal. Ses lits attendant qu’on prenne sa place ou celle d’un autre artiste, Fassbinder… J’ai beau avoir cherché à cette manière de se mettre derrière les apparences un jeu entre intelligible et sensible, je n’ai trouvé que des m2 de moquette pleins d’errance… L’accumulation des images, des dispositifs, des livres, des « chambres », des citations de citations a quelque chose de triste, de dévitalisé. Jusqu’au spectateur fantomatiquement mis en scène avec Séance de Shadow II (bleu) : des détecteurs déclenchant à son passage, par projection, son ombre sur un mur-écran. Après avoir été dans le plaisir de l’ignorance, et la découverte de la fêlure en 2007, comment puis-je, en 2015, n’être plus que l’ombre d’un dispositif qui assure à l’artiste sa présence ? Comment ne pas y voir, sans chercher bien loin, le mythe de la caverne de Platon ? On se souvient que devant un feu passent des « faiseurs de prestiges » qui portent des figurines au-dessus d’un muret et prononcent des paroles, dispositif qui tient des prisonniers enchaînés aux jambes et au cou depuis leur enfance dans l’illusion d’une réalité qu’on fabrique et projette. Aucune libération n’est envisageable pour eux puisque la réalité c’est l’illusion, et inversement. Ne reste alors au spectateur de Pompidou qu’à jubiler et applaudir comme eux à des ombres, la sienne y comprise.
Les « co-producteurs » de l’illusion sont au rendez-vous, d’autant que les ombres de la modernité que les spectateurs ont tant de plaisir à identifier et déjouer sont ici des citations. Elles valident tout, du propos inaugural de l’exposition à la boucle samplée de la reproduction, comme production de l’art dans une reconnaissance mutuelle qui fait consensus, l’accueil critique enthousiaste en témoigne. Mais si l’accumulation de références a quelque chose de rassurant pour le public qui est comme chez lui, elle ne peut cacher l’astucieuse capture du temps et de l’espace selon un quadrillage subjectif de l’artiste où la recherche d’une nouvelle citation consolide le processus architectonique de l’œuvre et l’époque (finissante ?) de la postproduction. En exposant un certain art de délimiter des zones de reconnaissance qu’il faut bien nommer culture, 1887-2058 a de ce point de vue une valeur de paradigme, même si la satisfaction qu’elle procure est aussi le signe de son échec : réduire le projet artistique contemporain au plaisir naïf de la reconnaissance, à la communion dans une illusion partagée.
Entre 2007 et 2015 a surgi la mélancolie d’un temps plus ancien, 1934, année où Walter Benjamin écrit « L’auteur comme producteur » : l’écrivain de divertissement bourgeois travaille, sans l’avouer, au service de certains intérêts de classes. Si l’art est à la citation et le politique à sa reconnaissance, alors l’artiste travaille sur, à, pour ses fins propres entraînant tous les discours suivant les points de découpe des citations dont ils se font durablement les relais au sein du monde des apparences.
Disparition des attentes ?
Quant à sentir remonter, fêlure et désir, à la surface : « Devenir ce que l’on est sans plus : qui voudrait perdre son temps à cela ? » Kierkegaard.
Corinne Rondeau